
Folio 120 pages
1ere publication 1982.
Ce roman est autobiographique, car l’auteur s’y met lui-même en scène pour nous emmener d’abord dans une clinique où il se remet d’une opération du poumon, au Baumgartnerhöhe dans les environs de Vienne. Son ami Paul Wittgenstein est lui aussi hospitalisé dans l’établissement de soin adjacent le Steinhof, qui est un hôpital psychiatrique.
Le narrateur hésite à aller rencontrer Paul que pourtant il chérit, vu les circonstances difficiles qui pourrait rendre cette entrevue pénible.
En fait, ils se verront deux fois, et peu de temps avant d’être "libérés" tous les deux.
Ce début en univers concentrationnaire est fort sombre, mais pour la suite du récit, l’auteur nous transporte dans les cafés qu’il fréquenta avec Paul, et dans des lieux extrêmement divers.
Si le récit est d’abord pathétique, quoique relaté froidement, la suite comporte quelques passages humoristiques lorsque l’auteur évoque les cérémonies ratées à l’occasion de deux de ses prix littéraires ; il nous fait rire aussi en brossant au vitriol quelques portraits de convives dans les cafés de Vienne, et d’autres personnes, tels ce couple de musicologues subitement atteints du syndrome du « retour à la nature » qui abandonne tout rapport à la musique et à l’intellect pour se transformer en agriculteurs.
Le titre fait évidemment songer au Neveu de Rameau. Il ne s’agit pourtant pas ici d’un dialogue entre le philosophe et le « fou » à propos de quelques sujets d’importance. L’auteur et Paul ont bien plus de points communs.
D’autre part, l’auteur n’est pas plus philosophe que son ami Paul, et ils le sont un peu l’un et l’autre.
Le neveu de Rameau n’était fou que dans le sens de la bouffonnerie et de la marginalité. Paul est également fou au sens premier du terme, il souffre de psychose, avec des symptômes graves.
L’auteur partage avec lui l’amour de la musique, la marginalité, certains symptômes délirants, et la critique féroce de la société dans laquelle ils vivent.
Thomas Bernhard développe un monologue sans chapitre, avec d’importants ressassements, comme à l’ordinaire, dans ses récits, mais ce roman ne fait pas partie de ceux dont la lecture peut-être considérée comme difficile. Malgré l'affirmation de sa personnalité, ( autodestruction et vouloir-vivre) qui occupe l'espace du récit Bernhard réussit à nous faire sentir la présence de Paul et à mettre en scène leur complicité et leurs débats.
Les Wittgenstein sont une famille d’entrepreneurs et de mécènes. Paul en est plus ou moins la brebis galeuse, mais il a plus d’un point commun avec Ludwig « Ludwig c’est sa philosophie qui l’ a rendu célèbre, l’autre Paul peut-être plus fou, mais il se peut que nous croyions du Wittgenstein philosophe que c’est lui le philosophe que parce qu’il a couché sur le papier sa philosophie et pas sa folie, et que nous croyions de l’autre Paul, que c’est lui le fou, que parce qu’il a refoulé sa philosophie au lieu de la publier, et n’a exhibé que sa folie. Tous deux étaient des être extraordinaires et des cerveaux tout à fait extraordinaires, l’un a publié son cerveaux l’autre pas ».
Bref nous devons considérer les êtres au-delà des rôles qu’ils sont contraints de jouer, sans pouvoir en faire l’impasse, car il n’est possible d’exister qu’à l’aide de ces rôles, non sans s’en défendre…
Ce récit peut se lire en même temps que ses autobiographies ( L'Origine, la Cave, le Froid, le Souffle, publiés de 1978 à 81 juste avant celui-là). Cependant, relire plusieurs oeuvres de Bernhard à la suite ne me convient pas vraiment.
J’ai voulu en savoir davantage sur Paul Wittgenstein, et n’ai pas trouvé grand-chose sur Internet ni ailleurs.
Toutefois, j’ai trouvé des propos fort intéressants sur Wittgenstein sur ce site :
http://remue.net/revue/TXT0110lecerf.html
Christine Lecerf , auteur de « Carnets de bord pour "Wittgenstein, la philosophie incendiée" écrit :
« Il est vrai qu’il a fallu attendre Thomas Bernhard et son génie du paradoxe pour restituer à Ludwig Wittgenstein ce qu’il avait toujours fui parce qu’il y était cruellement attaché : une famille, un foyer extraordinaire de contradictions, où se côtoyait le conformisme et l’extravagance, l’attachement à la tradition et le culte de la modernité. J’ai vérifié. Paul, le neveu de Wittgenstein, a vraiment existé, c’était le fils d’un frère de Karl Wittgenstein, le père de Ludwig. Dans cet esprit génial, gagné par la folie faute de pouvoir s’exprimer, Bernhard a cristallisé la tragédie dorée des fils Wittgenstein : étouffer sous sa propre richesse.’
Le neveu Paul était donc en fait pour Ludwig un cousin issu germain. Ce qui d’ailleurs n’a pas si grande importance. Lisez tout ce qu’écrit Christine Lecerf, ça en vaut la peine !
Thomas Bernhard est l’auteur du mois de novembre choisi par Sibylline sur Lecture-écriture
commenter cet article …


 Il y a trente ans, presque jour pour jour, que mourait Fritz Zorn, auteur zurichois d’un unique ouvrage autobiographique, « Mars ». Né le
Il y a trente ans, presque jour pour jour, que mourait Fritz Zorn, auteur zurichois d’un unique ouvrage autobiographique, « Mars ». Né le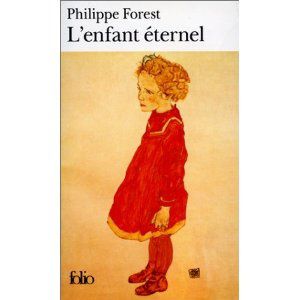
 Son œuvre autobiographique écrite en 1970-74 (Date à la fin du récit) est
rééditée chez Gallimard (L’Imaginaire).
Son œuvre autobiographique écrite en 1970-74 (Date à la fin du récit) est
rééditée chez Gallimard (L’Imaginaire).
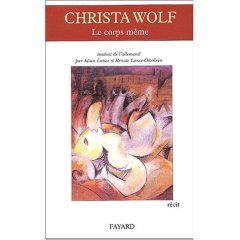 1-
1-/image%2F0557556%2F20180629%2Fob_5f6201_imag0243.jpg)